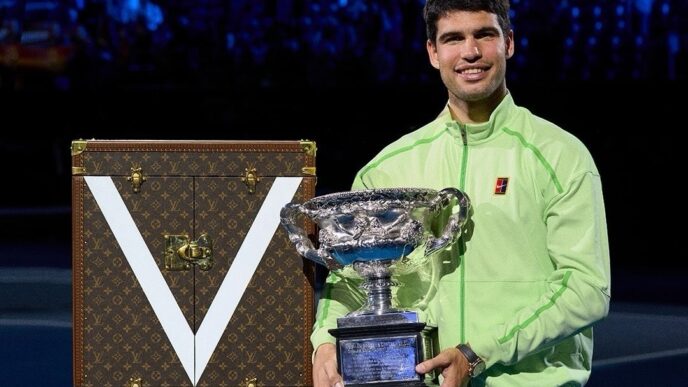Champion olympique de biathlon à Turin en 2006, Vincent Defrasne a depuis tracé une trajectoire singulière, loin des pistes mais toujours guidée par l’exigence du haut niveau. À l’heure où il s’apprête à célébrer les 20 ans de son sacre, il revient sur la genèse d’AYAQ, l’entrée de Mike Horn au capital, les défis business et sa vision du sport outdoor.
Vous vous apprêtez à fêter les 20 ans de votre titre olympique dans quelques jours. Est-ce que vous avez vu le temps passer ?
Oui et non, alors c’est ennuyeux les réponses « oui et non », mais c’est vrai. C’est vrai que j’ai fait tellement de choses différentes. Mon quotidien a changé, que ce soit côté famille et côté professionnel. Ma carrière s’est terminée, donc j’ai fait beaucoup de choses différentes, passionnantes et très prenantes. Ça me laisse l’impression que c’est assez loin, et puis à la fois, ça passe tellement vite, on m’en parle tellement souvent que ça paraît proche aussi. En tout cas, je mesure que depuis, il y a eu quand même pas mal de choses que j’ai pu faire dans ma vie.
Qu’est-ce qu’elle représente, avec le recul, cette médaille d’or olympique à Turin en 2006 ?
Je garde quand même des souvenirs très profonds. Parce qu’une carrière de sportif de haut niveau, c’est très partagé : on fait ça avec des gens, qui nous aident, nous accompagnent, mais c’est surtout une aventure très intérieure, très intime.

Vous avez lancé AYAQ, votre marque de vêtements outdoor éco-responsables, en 2020. À quel moment vous êtes-vous dit que ce projet pouvait devenir une entreprise viable, et pas seulement un engagement personnel ?
J’ai mis du temps à maturer l’idée, puis après à la valider, à me dire que ce n’est pas juste une idée ou une envie parce que je pense que la première bribe de pensée liée à AYAQ, c’était en 2013 à peu près. En effet entre 2013 et 2019, j’ai beaucoup maturé le projet, l’idée, j’ai vérifié que je l’avais au fond de moi, que ce n’était pas juste une envie légère. Assez rapidement quand même, je me suis lancé dans la réflexion de comprendre les tenants et les aboutissants du métier, d’un tel projet, et je me suis formé en faisant des rencontres, en me cultivant, en me renseignant sur le textile, le textile technique, le monde du business dans le sport de plein air… Donc à quel moment je me suis dit que ça pouvait être viable ? Je pense que c’est en 2017. Je me suis dit : « J’ai les idées claires, je me lance avec une grosse envie. »
J’ai pris le temps de terminer quelques beaux projets que j’avais à ce moment-là, notamment avec la fondation SOMFI (il a été directeur pendant 7 ans, NDLR). Je me suis lancé concrètement en 2019.
« Notre premier défi ? Le Covid ! »
AYAQ se positionne sur un marché très concurrentiel. Quel a été le principal défi business au lancement : le produit, la distribution ou la notoriété ?
Alors au lancement, ça a été le Covid (rires). On a été en pleine pandémie dans la fin du développement, dans le lancement en commercialisation. C’était le fameux hiver avec les stations fermées. Donc certes, il y a eu une grosse attention sur le sport de plein air, hors remontées mécaniques, le ski de randonnée, etc. Mais nous, on était tellement jeune, on arrivait tout juste, on avait zéro notoriété, donc on n’a pas bénéficié de ce gros boom du plein air. Il aurait fallu être arrivé depuis 2-3 ans pour bénéficier de ça, et ce n’était pas le cas, donc ça a été une grosse étape, une grosse difficulté d’entrée.
En six ans, AYAQ est passée à 12 salariés, des partenaires dans six pays et une production européenne. Comment fonctionne votre modèle économique aujourd’hui ?
On est multicanal en termes de vente. Dès le début, on a voulu lancer avec du wholesale, c’est-à-dire des boutiques partenaires, revendeuses de la marque, et la vente en ligne (https://ayaq.com/). Des partenaires, il y en a à peu près 120, un peu plus, qui revendent la marque dans ces six pays. Et puis, la vente en ligne grossit bien en ce moment. On y met un peu plus d’énergie maintenant. En plus de ces deux gros piliers, on pense à un troisième, qu’on ajoutera dans quelques années, avec des boutiques physiques. Mais on n’est pas encore assez mûrs pour ça. Il faut faire les choses étape par étape.
Vous êtes-vous fixé un horizon pour l’ouverture de votre première boutique ? Et un lieu ?
Non. On se dit que dans deux ou trois ans, ça serait bien. C’est ce qu’on imagine, mais ce n’est pas figé. Ce sera en grande ville. Après, le plan n’est clairement pas défini.
Avec Mike Horn, « une collaboration profonde »
Mike Horn est entré au capital de l’entreprise. Racontez-nous comment ça s’est goupillé ?
On se connaissait un petit peu de loin. On a eu l’occasion de se rencontrer il y a deux ans à peu près et on a tout de suite beaucoup parlé de nos activités. Lui m’a parlé de ses expéditions mais surtout de celle qu’il est en train de faire en ce moment parce qu’il la préparait, son expédition What’s Left. Et moi forcément je lui ai parlé de AYAQ. La discussion s’est vite animée. On a finalement fait connaissance en parlant d’expéditions, d’AYAQ et de vêtements pour les expéditions ou pour le sport de plein air. Avec beaucoup de passion des deux côtés, beaucoup d’idées et beaucoup d’énergie qui se sont développées dans les échanges. Assez rapidement on s’est dit : « Beh tiens, est-ce qu’on avancerait pas ensemble ? »
Ce qui lui a plu, c’est que je lui parle en profondeur. Je ne lui ai pas proposé de juste faire un contrat marketing pour faire un peu de pub. Je lui ai proposé qu’on avance en profondeur ensemble, qu’on développe des vêtements, qu’il soit très impliqué dans le développement des gammes. Et ça, c’est quelque chose qui l’a intéressé. Des marques qui aimeraient travailler avec lui, il y en a plein. Mais c’est parfois et très souvent assez en surface. C’est de la communication uniquement. Alors que là, on est vraiment lancé dans quelque chose de beaucoup plus profond où on travaille de la stratégie de l’entreprise, on travaille les vêtements et le développement produit et le test terrain. Évidemment, on va faire de la communication, mais on est vraiment dans une collaboration qui est bien plus profonde.
Quel rôle joue-t-il officiellement ?
Il est actionnaire, il est directeur général délégué au développement produit et puis évidemment il est un des grands ambassadeurs, voire le grand ambassadeur. Il n’est pas au quotidien dans AYAQ parce qu’évidemment il veut et on veut le garder explorateur donc il est sur son bateau et on travaille d’une manière assez originale mais on travaille le développement.
produit, les tests terrain et pas mal de choses qui touchent à d’autres domaines dans AYAQ.
Vous comparez souvent l’entrepreneuriat au sport de haut niveau. En quoi créer une marque est-il, selon vous, aussi exigeant que devenir champion olympique ?
Ouais, c’est qu’en effet il y a de la concurrence. Si on est dans un secteur porteur, il y a forcément de la concurrence. S’il n’y a pas de concurrence, c’est que le secteur ne soit pas porteur, soit il est en train de le devenir et la concurrence va vite arriver. C’est la compétition, avoir envie d’être dans les meilleurs. Je retrouve ça si je ne l’ai pas pour AYAQ, ça ne va pas fonctionner. Si je ne l’avais pas pour ma carrière et pour le titre de champion olympique, ça n’aurait pas fonctionné. Aimer la concurrence, aimer la compétition, avoir envie d’être le meilleur ou dans les meilleurs, je trouve que c’est un peu un parallèle.
Puis après tout ce que ça implique, c’est de se donner, de beaucoup travailler, d’avoir de la passion, de travailler en équipe parce qu’on ne peut pas développer une marque référente outdoor où on ne peut pas être champion olympique tout seul dans son coin. On a besoin des autres, on a besoin d’une équipe, on a besoin de compétences, on a besoin de se relever quand ça foire, quand ça ne marche pas. Il y a beaucoup de parallèles.

Parfois, on travaille beaucoup, mais on n’est pas récompensé. En sport comme dans l’entreprenariat.
Oui, des fois les fruits du travail se font attendre, voire parfois il y a des échecs ou des problèmes qui tardent à être résolus. Je l’ai vécu en biathlon, je l’ai vécu avec AYAQ très régulièrement. C’est ça, se relever, persévérer, trouver des solutions. Quand des fois au tir je mettais tout à côté sur une période parce que ça arrive aux athlètes, des fois au tir tu es un peu perdu, tu ne sais pas trop pourquoi, il faut trouver des solutions, il faut se reposer, il faut retravailler. Quand on a des problèmes, il faut les analyser et se renforcer.
Dans votre parcours entrepreneurial, quelles faiblesses avez-vous découvertes chez vous ?
J’ai des faiblesses liées à peut-être à ma personnalité mais aussi à mon parcours parce que je n’ai pas fait d’études supérieures, il y a des choses que je n’ai pas apprises à l’école ou en études. Mes études, c’était du biathlon. Même si j’ai fait un peu STAPS, je n’ai pas eu de vie professionnelle à part à l’aube de ma reconversion. Par contre, mes reconversions m’ont beaucoup formé, j’ai appris plein de choses mais mes lacunes, peut-être que je suis un peu trop impatient parfois, il faudrait que j’aie un peu plus de patience parfois en effet. Ça peut être une lacune parfois de vouloir trop foncer ou d’être trop impatient parce qu’il y a des choses où il y a un temps nécessaire, on ne peut pas accélérer ou ce n’est pas raisonnable d’accélérer.
Mes lacunes, c’est un peu celles que je comble avec mes zones de non compétences, c’est les choses que je comble avec mes associés, notamment Rodolphe, mon bras droit qui est presque co-fondateur. Ce sont des aspects de gestion administrative où ce n’est pas ma tasse de thé, de gestion financière ou soit je ne sais pas faire certaines choses soit je n’ai pas envie de le faire, donc ça reste une lacune.
« On n’a pas dénaturé le sport »
À l’approche des JO d’hiver de Milan-Cortina 2026, comment regardez-vous l’évolution du biathlon et plus largement du business des sports d’hiver ?
Le biathlon, il évolue de manière spectaculaire, même si le biathlon d’aujourd’hui n’est pas complètement différent de ce que j’ai pu connaître du temps de ma carrière. Il y a quand même une évolution. Les choses grossissent, grandissent. Je trouve que le biathlon se porte bien. C’est un des petits sports qui attire beaucoup l’attention et c’est sympa même si on ne fait pas forcément du sport que pour l’attention. D’avoir beaucoup d’attention en France mais aussi dans beaucoup de pays, ça aide le développement du sport.
Je trouve que c’est bien parce qu’il y a un gros développement mais en ayant gardé les racines du biathlon, en ayant gardé l’ADN premier de ce qui fait une belle course de biathlon. Les nouveaux formats qui ont été inventés, je les trouve cohérents par rapport à l’histoire du biathlon. On n’a pas dénaturé le sport pour le développer donc je trouve ça super et précieux.
Plus globalement, le sport est l’avenir de l’homme. C’est prétentieux de dire ça, mais je trouve que le sport est une très belle chose pour l’être humain, pour les êtres humains, pour les communautés, qu’elles soient nationales, et même pour le bien du monde au sens large. Je trouve que le sport au sens large et le sport de plein air sont des choses très précieuses pour l’humain et les êtres humains. Donc son développement économique, je le trouve logique. On a de plus en plus une prise de conscience que le sport de plein air apporte aux gens et aux communautés. Et je trouve ça super !
Avez-vous prévu d’aller à Milan pour fêter les 20 ans de votre titre ?
Je ne sais pas encore. J’en ai envie mais j’ai tellement d’occupations et passionnante en ce moment que je suis en train d’arbitrer un peu des choses dans mon agenda. Je n’ai encore pas validé si j’y allais ou pas. Je dois y aller trois jours normalement mais je n’ai pas envie d’y aller en coup de vent ou en étant préoccupé par trop d’autres choses donc je suis en train de voir. Mais en tout cas je vais fêter la médaille ça c’est sûr. Soit depuis la France, soit depuis la montagne, soit depuis là-bas, mais je n’ai encore pas décidé.
À lire aussi : JO de Milan-Cortina : « Le partenariat ultime en termes de valeurs et d’image », estime Elise Dupuis, directrice marketing de TCL